SOMMAIRE DES ARTICLES DU BLOG ET LIENS DIRECTS
1- 1968 - P. Z. (Photochrom Zurich) - Cannes, La Vieille Ville, sans date,
épreuve chromophotographique de 16,4x22,4 cm,
Washington, Library of Congress.
INTRODUCTION
Il existe une série constituée de plus d'une centaine de vues de la Riviera (de Cannes à Gênes), colorisées avec le procédé suisse "Photochrom", dont une trentaine de vues de Cannes et des Îles de Lérins.
PHOTOCHROM ZÜRICH
Procédé
Ce procédé de colorisation est mis au point par Hans Jacob Schmid (1865-1924), employé lithographe de la maison d'édition "Orell Füssli & Cie" de Zurich, dirigée par Henri Wild (1840-1896) et ses frères (1). Cette maison en dépose le brevet en 1888 et créé, dès 1889, une société distincte dédiée à l'exploitation commerciale des vues en couleurs, sous le nom de "Photochrom & Cie".
Le procédé est à mi-chemin entre la photographie et la lithographie. Il repose sur le transfert de l'image d'un négatif noir et blanc sur une série de plaques lithographiques recouvertes d'une émulsion photosensible puis exposées à la lumière solaire. Avec l'encrage d'une plaque par couleur, un grand nombre de tirages sur papier sont effectués lors de plusieurs passages successifs (2).
Le succès de ces images en couleurs est immédiat. En 1889, la Société Photochrom fait une grande exposition de ses vues à l'Exposition Universelle de Paris (de mai à octobre) puis à la Galerie Appenzeller de Zurich (en septembre) (3).
En 1890, la création de la nouvelle Société par actions, "Photoglob Co" (vues en couleurs du monde entier) englobe la Société Photochrom (4).
Photoglob fusionne en 1895 avec la Société de photographie industrielle "Schroeder & Cie" de Zurich et crée des filiales à Londres (en 1895) et à Détroit (Michigan, en 1896).
VUES DE LA RIVIERA
Présentation
Des vues de la Riviera sont conservées dans de nombreuses Institutions internationales, parmi lesquelles la Zentralbibliothek Zürich et la Library of Congress in Washington mais également dans des Collections privées (5).
Ces vues sont le plus souvent accompagnées d'une légende sous ou dans l'image. Lorsque la vue est montée sur un support, la légende est inscrite sur une étiquette rectangulaire collée sous le milieu de l'image ; elle précise, généralement à l'encre noire, le numéro de série (en grands caractères verticalisés sur le côté gauche), le nom de l'éditeur puis le titre en deux langues (notamment en français et allemand).
Lorsque la vue ne dispose pas d'un support, cette légende est généralement inscrite à l'encre blanche ou grise, au bas de l'image elle-même (à gauche ou à droite) et précise le numéro, le nom de l'éditeur puis le titre (notamment en français).
Datation
Les images de la Riviera sont globalement datées entre 1889 et 1914, par la Bibliothèque centrale de Zurich et entre 1890 et 1900, par la Librairie du Congrès de Washington.
La série est constituée de sous-ensembles réalisés à des dates différentes par plusieurs photographes, certains missionnés par la Société et d'autres indépendants, auprès desquels la Société a acquis les négatifs. Une datation précise ne peut se faire que vue par vue ou bien par groupes de vues aux numéros proches.
L'hypothèse d'une utilisation de négatifs antérieurs au procédé est à écarter pour les vues de la Riviera car toutes les vues urbaines montrent des constructions ou des aménagements réalisés dans la seconde moitié des années 1880 ou dans les années 1890.
Parmi les vues en couleurs les plus anciennes de la Riviera, il y a celles qui ont été présentées à l'Exposition Universelle de Paris en mai 1889 (dont quatre vues de Cannes) (6).
2- 1968 - P. Z. (Photochrom Zurich) - Cannes, La Vieille Ville, sans date,
épreuve chromophotographique de 16,4x22,4 cm,
Washington, Library of Congress.
VUE DE CANNES : LA VIEILLE VILLE
Description
La vue de Cannes étudiée mesure 16,4 x 22,4 cm et porte, au bas et à gauche de l'image, les indications suivantes inscrites à l'encre blanche, "1968 - P. Z. - Cannes, La Vieille Ville" (Image 2 ci-dessus).
C'est une vue pittoresque nord-sud, prise depuis la route de Grasse et le quartier de la Ferrage, tôt le matin. Le soleil illumine les façades orientales des bâtiments et l'horloge de la Tour du Suquet affiche "7h 09" (probablement un jour d'été). On entrevoit le Cours, le Port et les Îles.
Le centre ville s'offre au regard avec, de gauche à droite, les quartiers du Poussiat et de Saint-Antoine puis celui historique du Suquet sur le Mont-Chevalier. C'est ce dernier qui justifie le titre donné à la vue, malgré la présence d'un quartier récent au tout premier plan dont voici la description détaillée.
Un chemin suit le flanc du coteau, à travers champs et vergers, jusqu'à une passerelle piétonne qui enjambe la voie ferrée et aboutit au boulevard de la Ferrage, situé en contrebas (actuel boulevard Victor Tuby).
En face, la rue des Marchés (actuelle rue du Dr Pierre Gazagnaire) conduit à la Halle de la Boucherie publique (bâtiment clos), à la Chapelle Notre-Dame de la Miséricorde et à la Halle de la Poissonnerie publique (emplacement couvert), proches du Marché Forville, avant de croiser la Grande rue (ou rue Grande, actuelle rue Meynadier) et d'aboutir sur le Cours, près de l'Hôtel-de-Ville (Image 3 ci-dessous).
Sur la gauche de l'image, la rue du Poussiat (actuelle rue des Halles) mène quant-à-elle au centre de la place du Marché Forville puis débouche dans la Grande rue, derrière laquelle se détache la haute silhouette de l'Hôtel-de-Ville (Image 2 ci-dessus).
3- Détail de la partie centrale de l'Image étudiée, centré sur la rue des Marchés,
1968 - P. Z. (Photochrom Zurich) - Cannes, La Vieille Ville, sans date,
épreuve chromophotographique de 16,4x22,4 cm,
Washington, Library of Congress.
1- Passerelle piétonne (érigée en 1882-83) franchissant la voie ferrée Marseille-Nice et desservant,
par un escalier à double rampe (du côté sud), le boulevard de la Ferrage.
2- Boulevard de la Ferrage (actuel boulevard Victor Tuby)
avec, dans les années 1890, des immeubles en partie numérotés
et alternant, d'est en ouest, les numéros pairs et impairs.
3- Rue des Marchés (actuelle rue du Dr Pierre Gazagnaire) ouverte dans la première moitié des années 1870 avec, dans les années 1890, des immeubles en partie numérotés et présentant,
du sud au nord, des numéros croissants, pairs du côté ouest et impairs du côté est.
4- Immeuble érigé vers 1880 mais accosté d'un échafaudage, probablement pour le crépissage de ses façades.
(À l'image de nombreuses architectures du quartier, le bâtiment est conservé de nos jours ;
il présente cependant un niveau supplémentaire).
5- Immeuble le plus récent de la rue, érigé dans les années 1880, avec une date qui reste à préciser. Il apparait faussement en retrait par rapport à l'immeuble d'en face (virage) et présente, lui aussi, quatre niveaux pourvus de balcons dans l'angle adouci (et apparait de nos jours surhaussé d'un niveau supplémentaire).
6- Boucherie publique installée en 1872-73 dans un immeuble de deux niveaux
situé à l'angle de la ruelle Forville, face à la Chapelle de la Miséricorde.
L'inscription "Boucherie" est lisible au sommet de la façade.
7- Eglise ou Chapelle des Pénitents noirs de Notre-Dame de la Miséricorde (érigée au début du XVII° siècle). Seules, l'abside et l'extrémité de la tour-clocher couronnée d'une flèche qui l'accoste au sud, sont visibles.
(La Halle de la Poissonnerie - non visible dans l'image - est présente sur le côté opposé de la Chapelle).
ÉVOLUTION DU QUARTIER
Partie sud
La partie sud du quartier, comprise entre la rue Grande et la rue Forville, date d'une période antérieure à la Révolution. A partir des années 1860, ses rues sinueuses, malpropres, privées d'air et de lumière et bordées de maisons délabrées vont progressivement disparaître au profit de rues droites et larges aux façades neuves et alignées. Cette rénovation va s'étaler sur plus de vingt ans, nécessitant expropriations, démolitions et reconstructions (7).
Les travaux d'élargissement de la rue Vassal et de son prolongement depuis le Cours jusqu'à la Chapelle de la Miséricorde, débutent en 1866. Ils vont permettre, fin 1872, d'implanter la Halle aux Poissons près du côté sud de l'édifice religieux.
Plus à l'est, la rue parallèle du Poussiat qui va de la Grande rue à la rue Forville, se voit également élargie dans les années 1860. Enfin, les maisons situées tout le long du côté sud de la rue Forville sont démolies en 1882-1884, afin d'établir la "place des Marchés", renommée, en décembre 1884, "place du Marché Forville".

4- Cannes, vue générale, prise depuis le nord-est, détail, vers 1862-68,
estampe parue dans Le Monde Illustré du 16 janvier 1869.
Partie nord
La partie nord du quartier, comprise entre la rue Forville et la voie ferrée et mise en évidence dans l'image étudiée, est la partie récente. Elle ne s'est développée qu'à la suite de l'installation de la voie de chemin de fer et du percement du tunnel sous le Mont-Chevalier (en 1860-1861) mais n'a été bâtie qu'après 1870 et la cession à la Commune des "terrains hors-lignes" détenus par la Compagnie de Chemin de fer (le tunnel, visible dans l'Image 4, est situé juste après la limite droite de l'image étudiée).
Ce sont la rue du Poussiat et la rue Vassal qui, grâce à leur prolongement vers le nord, vont venir relier les parties ancienne et nouvelle du quartier.
La rue Vassal (Image 5 ci-dessous) voit tout d'abord son côté ouest bordé, dans la première moitié des années 1870, de trois immeubles (Images 6 et 7 ci-dessous). La rue est ensuite renommée, en 1876, "rue des Marchés". Un dernier immeuble vient compléter ce côté, à l'angle du boulevard de la Ferrage, dans les années 1880 (à une date qui reste à préciser).
Le côté est de la rue ne va, pour sa part, être bâti qu'à partir de la fin des années 1870, avec une succession de six immeubles.
5- ALEO Miguel (1824-c.1900), Détail d'une Vue de Cannes, prise de la route de Grasse, vers 1868,
Collection privée.
L'image montre la partie du quartier comprise entre la Chapelle de la Miséricorde (accostée au sud-est de sa tour-clocher et au sud-ouest d'un grand arbre) et la voie ferrée. La zone est alors constituée de quelques maisons basses et de jardins.
"Les rues du Suquet, de Saint-Antoine et de la Miséricorde conduisent à la Chapelle-des-Pénitents, édifice construit dans un quartier très retiré. Une petite tourelle carrée, surmontée d'une toiture aiguë, couverte en tuiles de couleurs brillantes, domine la nef. Celle-ci ne renferme pas d'objets d'art dignes d'attention, sauf l'autel en marbre qui date du siècle dernier" (Victor Petit, Cannes - Promenades des étrangers dans la ville et ses environs, Cannes, F. Robaudy, 1868, p 268).
6- Photographe anonyme, Détail d'une Vue de la ville de Cannes prise de la route de Grasse, vers 1873.
Collection privée.
Le grand arbre de la place de la Miséricorde (visible sur l'image précédente) a été coupé lors de l'installation de la Halle de la Poissonnerie. La Chapelle de la Miséricorde, dont les murs ont été blanchis vers 1870, apparait dégagée des masures qui l'accostaient à l'est.
Plus au nord, un seul côté de la rue Vassal (future rue des Marchés) commence à être flanqué de bâtiments (au nombre de trois).
Un grand terrain bordé d'arbres occupe l'emplacement de la future rue du Poussiat et de vieilles bâtisses,
celui de la future place du Marché.
Au premier plan de l'image, la voie ferrée domine les maisons qui s'échelonnent jusqu'au bord de mer.
7- J. LÉVY & Cie [Georges Lévy (1833-1913) et Moise Léon (1812-1888)],
Détail d'une Vue de Cannes, prise du nord-est, vers 1873,
Collection privée.
Cette vue présente, sous un autre angle, un état du quartier semblable à celui de la vue précédente mais a l'avantage de montrer la couverture de la Halle de la Poissonnerie publique, érigée en trois mois, à la fin de l'année 1872, du côté sud de la Chapelle de la Miséricorde.
Au nord de la Chapelle, le bâtiment qui a été érigé vers 1872-73 (suivi d'une impasse qui le sépare du bâtiment suivant et existe encore de nos jours) est celui de la Halle de la Boucherie publique.
Un arrêté municipal du 4 octobre 1873 prohibe, à partir du 3 novembre suivant, la vente du poisson et de la viande de boucherie sur les Allées de la Marine, et décide qu'à l'avenir ces denrées ne pourront être mises en vente que sur les hors-lignes de la rue Vassal.
Entre 1874 et 1878, une voie parallèle à la rue des Marchés vient s'inscrire dans la continuité nord de celle du Poussiat (avant d'adopter ce même nom en décembre 1884). À la fin des années 1870, seul son côté ouest apparait complété de trois bâtiments. Le plus septentrional d'entre eux, situé à l'angle du chemin de la Ferrage se voit rattaché, vers 1880, à une nouvelle construction qui vient former l'angle de la rue des Marchés.
Le chemin de la Ferrage, qui longe la voie ferrée, a déjà été rectifié et élargi à plusieurs reprises dans les années 1860 et 1870. Il va être flanqué de maisons au tournant des années 1880 et être transformé, en 1881, pour devenir le "boulevard de la Ferrage".
Une passerelle piétonne, située dans l'axe de la rue des Marchés et munie d'un escalier à deux rampes, est érigée en 1882 et 1883. Elle permet de franchir la voie ferrée et d'emprunter le chemin qui conduit, plus au nord-est, au Collège Stanislas et à l'Hôtel Continental.
Boulevard de la Ferrage
L'ensemble du quartier est très commerçant, comme le révèlent les Annuaires des Alpes-Maritimes contemporains de la vue étudiée (années 1890).
Les métiers les plus représentés sont ceux de l'alimentation (boucheries, charcuteries, poissonneries, épiceries, primeurs, fromager, eaux, vins, liquoriste, cafés, buvettes, auberge).
Il existe cependant des boutiques variées (quincaillier, mercier, vannier, tapissier, tissus, tailleurs, chapeliers, corsetière, blanchisseuse, marchands de tissus, de nouveautés, de chaussures, bazar, coiffeur) et des ateliers (maçons, ferblantiers, chaudronnier, plombier-zingueur, scierie) qui se déploient sur les places du Marché Forville et de la Miséricorde mais aussi dans la rue du Poussiat et celle des Marchés (pour ne parler que des rues étudiées ici).
Quelques commerces et ateliers sont également situés boulevard de la Ferrage. L'image étudiée révèle notamment la présence de six d'entre eux au rez-de-chaussée des immeubles du premier plan. Leurs inscriptions ou enseignes sont parfois illisibles, masquées partiellement par le feuillage des arbres plantés des deux côtés de la voie ferrée ou inscrites en caractères trop petits. Trois d'entre elles sont cependant déchiffrables.
8- Détail d'une partie gauche de l'Image étudiée, montrant une maison du boulevard de la Ferrage,
à l'angle de la rue du Poussiat,
1968 - P. Z. (Photochrom Zurich) - Cannes, La Vieille Ville, sans date,
épreuve chromophotographique de 16,4x22,4 cm,
Washington, Library of Congress.
(Ce bâtiment, érigé vers 1877, est conservé tel quel de nos jours,
à l'angle de la rue des Halles et du boulevard Victor Tuby).
A l'angle de la rue du Poussiat et du boulevard de la Ferrage (côté ouest), on peut lire l'inscription "B. Lions - (...)cteur - (...) Cuivre - En Fer", qui identifie l'atelier de B. Lions, constructeur de chaudières (Image 7 ci-dessus).
A l'angle du boulevard de la Ferrage et de la rue des Marchés (côté est), se trouve cette fois l'enseigne suivante : "(.?) Entrepôt de Vins et de Spi(...)", qui désigne A. Olivier, revendeur de vins et spiritueux (Image 3). Ce dernier semble disposer également d'une entrée au n° 5 de la rue du Poussiat.
Enfin, au-dessus de la porte de la troisième maison située après la passerelle, se note le texte : "Atelier de Cons(...)", qui identifie cette fois l'atelier de G. Repetto & Ortelli, constructeurs-mécaniciens installés au n° 12, dans la maison Robilis (Image 2).
DATATION DE LA VUE
Numéro et titre de la vue
La vue étudiée n'est répertoriée sous l'intitulé, "1968 - Cannes, La vieille ville vue depuis la route de Grasse" (Cannes - Die alte Stadt von der Straße von Grafje aus gejehenle), qu'à partir du Catalogue des Photochroms paru en janvier 1896, alors qu'elle est encore absente de celui d'avril 1895 (8), ce qui situe probablement l'achat du négatif et l'édition de la vue en couleurs entre ces deux dates, avec une prise de vue qui peut cependant être antérieure (9).
Son négatif a pu être réalisé par l'un des photographes missionnés par la Société ou par l'un de ceux qui ont multiplié les vues de Cannes durant les années 1890, comme les Frères Neurdein de Paris ou Jean Giletta de Nice. Cependant, il peut être l'œuvre de la Société suisse Schroeder & Cie qui a justement réalisé une série de vues de Cannes, vers 1895, peu avant sa fusion avec Photoglob (10).
Indices fournis par l'image
Le premier indice qui implique le milieu des années 1890 vient de la présence, près du phare du Port, de la jetée prolongée.
9- Détail d'une partie centrale de l'image étudiée montrant la jetée du Port,
1968 - P. Z. (Photochrom Zurich) - Cannes, La Vieille Ville, sans date,
épreuve chromophotographique de 16,4x22,4 cm,
Washington, Library of Congress.
Ce projet a été validé par le Ministère des travaux public, le 26 avril 1892. Les travaux ont été adjugés le 12 juillet suivant et n'ont été achevés qu'au cours de l'année 1897, sans que le déroulement détaillé de ces derniers ne soit connu (11).
La vue montre déjà une partie réalisée des deux branches successives de la nouvelle jetée, vers le sud puis l'est, avec un bateau tout proche qui participe peut-être aux travaux (Image 8 ci-dessus).
Le second indice vient du relevé des inscriptions et enseignes du boulevard de la Ferrage. L'atelier de construction de chaudières de B. Lions n'a emménagé à cette adresse qu'à partir de 1894 car il est cité pour la première fois dans l'Annuaire des Alpes-Maritimes de 1895.
Quant à l'entrepôt de vins et spiritueux d'A. Olivier, il semble n'avoir ouvert qu'en 1895 car il est cité pour la première fois dans l'Annuaire des Alpes-Maritimes de 1896 (12).
Le négatif noir et blanc de l'image étudiée semble donc avoir été réalisé en 1895, avec une vue éditée en couleurs peu de temps après, lors de la même année.
NOTES
(1)- Cette imprimerie séculaire, reprise au XVIII° siècle par Orell, Gessner, Füssli et Cie a perduré au XIX° siècle avec Ziegler et Hagenbuch puis Fisch et Wild. À partir de 1863, elle est dirigée par Henri Wild et ses frères puis leurs enfants.
En 1880, la Société "Artistiches Institut Orell, Füssli" est créée, avec en parallèle la construction de nouveaux et vastes locaux à Zurich (comprenant une imprimerie, une fonderie de caractères, des ateliers de gravure sur bois, de clicherie galvanoplastique, de lithographie, de photographie industrielle et de phototypie) et l'ouverture d'une filiale à Milan.
(2)- Pour une description détaillée du procédé, voir, Le Moniteur de la Photographie du 15 novembre 1898 pp 339-343.
Les retouches manuelles vont progressivement disparaître et les teintes pâles vont laisser la place à des teintes plus vives. Le prix des grands formats restera élevé.
(3)- Les Frères Wild remportent une médaille d'or à l'Exposition Universelle de Paris en 1889 mais pour leur Société Orell, Füssli et Cie, dans la catégorie Imprimerie et Librairie (Groupe II, Classe 9), pour la qualité de leurs livres d'enseignement.
La Société Photochrom sera cependant plusieurs fois récompensée lors de ses expositions dans différents pays. Citons, en France, la médaille d'argent remportée à l'Exposition Universelle, Internationale et Coloniale de Lyon en 1894 et la médaille d'or à l'Exposition de Bordeaux en 1895.
(4)- Les Frères Wild sont alors les principaux actionnaires de trois sociétés par actions : l'Institut artistique Orell-Füssli, l'Agence de publicité Orell Füssli et la Photoglob Cie.
(5)- Voir les Photochroms de la Zentralbibliothek (ici) et ceux de la Library of Congress (ici) ou sur Wikimedia (ici).
De nombreux Catalogues répertoriant les vues de la Riviera sont conservés en français ou en allemand, à partir de l'année 1891, à Zurich, dans les collections de la Bibliothèque centrale et dans celles de l'Université.
Par exemple, le Catalogue Manuel des Photochroms, paru en décembre 1897 (Extrait du Catalogue général de la Photoglob Co, Zurich, vol. 3, La France, L'Espagne, l'Alger, Tunis, La Belgique, Le Luxembourg, La Riviera, L'Italie, La Russie), répertorie à cette date, en pages 16 à 19, la vue étudiée parmi 123 vues de la Riviera : 1 de 12x17 cm, 113 de 16x22 cm et 9 de petits ou moyens formats panoramiques, avec 14 vues de Cannes de 16x22 cm classées par numéro (du n° 1062 au n° 8097) et 1 panorama de 19x50 cm (n° 4557).
(6)- Cette Liste présentée à l'Exposition Universelle de Paris en 1889 est notamment mise en évidence dans les Catalogues de Photochroms du 15 novembre 1891 et du 15 février 1892 (Zentralbibliothek Zürich).
La vue 1073 - Nice, le Boulevard du Midi, montre par exemple le tout récent et monumental Escalier Lesage qui permet d'accéder directement au sommet de la Colline du Château. Or ce dernier, commencé en juin 1888, n'a été achevé qu'en novembre 1888. La vue a donc été prise entre le dernier trimestre de l'année 1888 et le premier trimestre de l'année 1889 (date d'ouverture de l'Exposition Universelle) et laisse penser à une date semblable pour les autres vues aux numéros proches.
Dans la décennie suivante, les vues de la Riviera situées au-dessus du n° 8000 semblent pour leur part correspondre aux années 1896-97. En effet, la vue 8295 - Nice. La Jetée-Promenade et le Monument du Centenaire (monument érigé au sud des nouveaux jardins réalisés sur le couvrement du Paillon à son embouchure), n'a pu être prise qu'entre mars 1896, date de l'inauguration du Monument, et décembre 1897, date de parution du Catalogue des Photochroms.
L'interprétation des numéros en dates doit cependant rester prudente car au sein même de la Société de Zurich (vues et Catalogues de 1897 et 1899 de la Bibliothèque centrale de Zurich), certaines vues ne sont pas citées dans les extraits du Catalogue général et parmi celles qui le sont, les petites vues et les vues panoramiques adoptent une numérotation qui leur est spécifique.
La Detroit Publishing Company (D.P.C.) diffuse pour sa part, les mêmes images mais avec une numérotation différente (vues de la Librairie du Congrès, Washington et Catalogue de 1905).
(7)- Les Registres de Délibérations du Conseil municipal consultés (entre 1860 et 1900) sont en ligne sur le site des Archives Municipales de Cannes (1D15 à 1D37).
(8)- Dans le Catalogue de janvier 1896, seules quatre vues présentent un numéro proche de celui de la vue étudiée ("1968"). Ce sont d'ailleurs quatre vues de la ville de Cannes, également absentes du Catalogue d'avril 1895, numérotées de 1997 à 2000 et respectivement intitulées : 1997 - Cannes. Boulevard de la Croisette ; 1998 - Cannes. Le Cours et la Californie ; 1999 - Cannes et l'Estérel. Vue prise depuis la Villa Nevada ; 2000 - Cannes et les Îles de Lérins. Vue prise de la Croix des Gardes.
Parmi celles-ci, la vue légendée, 1997 - Cannes. Le Cours et la Californie, montre notamment, sur le boulevard de la Croisette, la Villa Lehoult qui a été érigée vers 1893-94 et n'est citée qu'à partir de l'Annuaire des Alpes-Maritimes de 1895. Une date de prise de vue au cours des années 1894 ou 1895 s'avère donc crédible.
(9)- Le décalage entre le moment de la prise de vue et le moment de l'édition peut-être de plusieurs mois, voire de plus d'une année. Les Vues de Palestine "faites en 1894 sur les lieux par des artistes au service du Photochrom zurichois" ne sont ainsi éditées en couleurs (vues individuelles et albums) qu'à la toute fin de l'année 1895 (Journal de Genève du 21 décembre 1895).
(10)- Parmi les vues de Cannes réalisées par Schroeder & Cie, sept épreuves photomécaniques noir et blanc, portant des numéros échelonnés entre le 3412 et le 3477, sont notamment conservées dans une Collection privée. Trois d'entre elles montrent la Villa Lehoult érigée en 1893-94 sur le boulevard de la Croisette et présentent la mention manuscrite de l'acheteur, "janvier 1897".
(11)- Seule la volonté de signaler les enrochements en cours par une bouée ou un feu, est évoquée en octobre 1893, décembre 1894 et juin 1896. Des améliorations comblant les interstices entre les rochers sont encore décidées lors d'un Conseil municipal de mai 1897.
Voir : Le Journal de Monaco du 3 octobre 1893, les Délibérations du Conseil municipal du 14 décembre 1894 (Archives Municipales de Cannes, Registre 1D35), le Moniteur de la Guyane française du 20 juin 1896, les Délibérations du Conseil municipal du 18 mai 1897 (Archives Municipales de Cannes, Registre 1D37).
(12)- Les Annuaires des Alpes-Maritimes sont en ligne sur le site des Archives Départementales des Alpes-Maritimes.
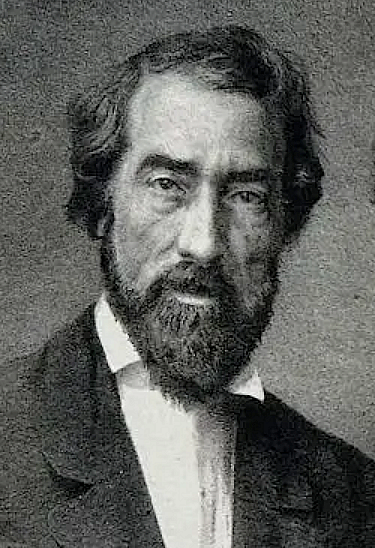












%20(1bRc).jpg)


